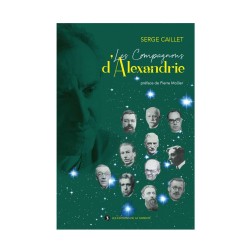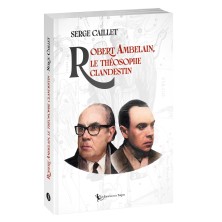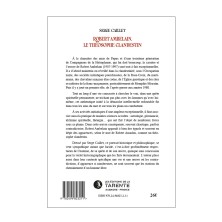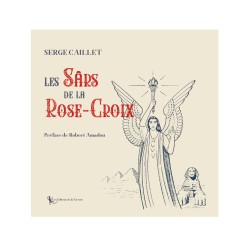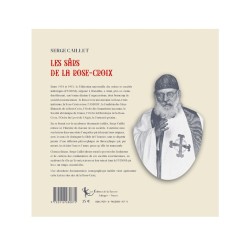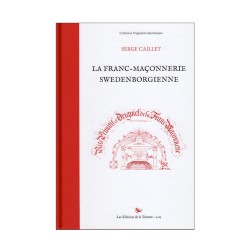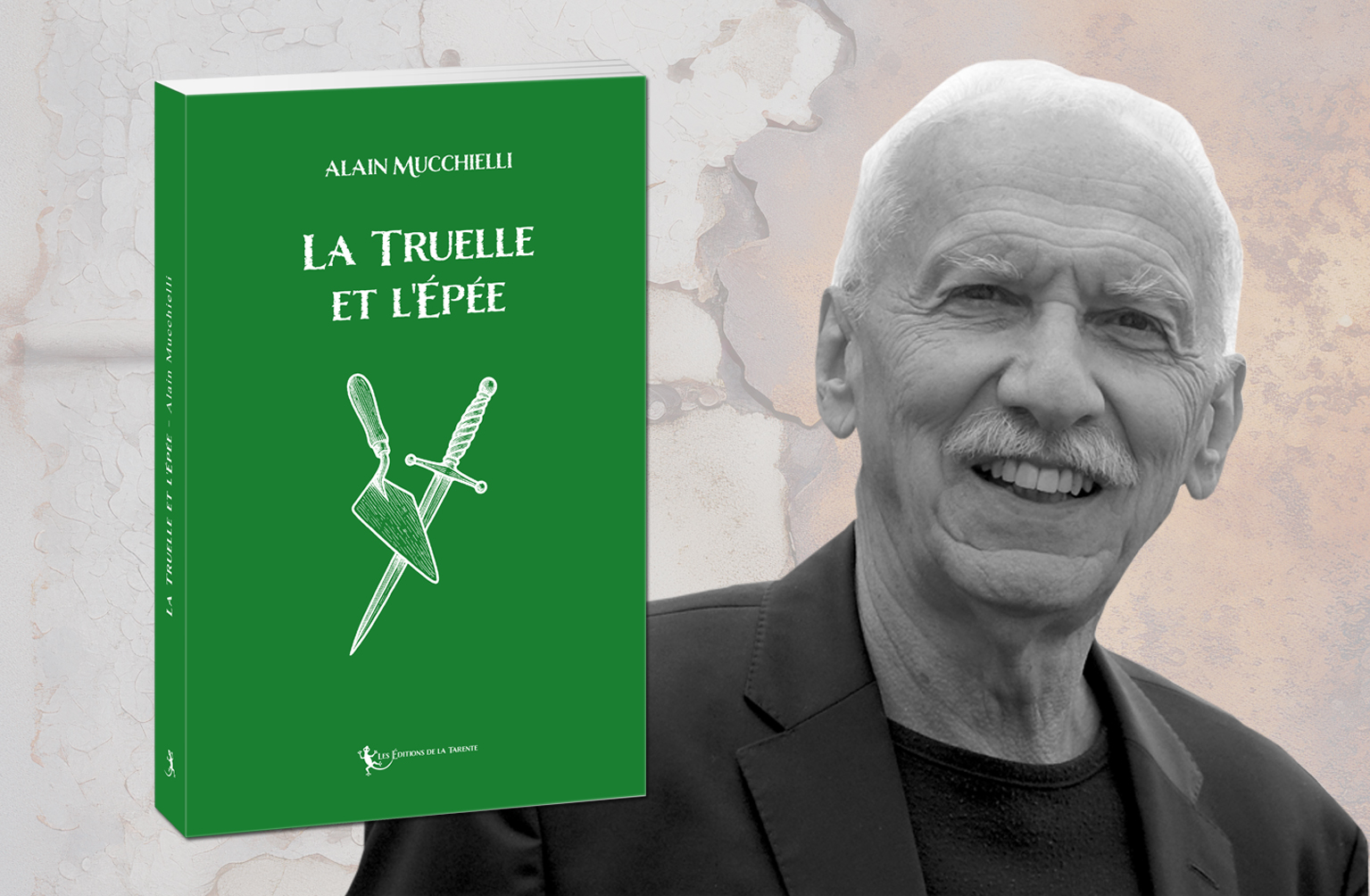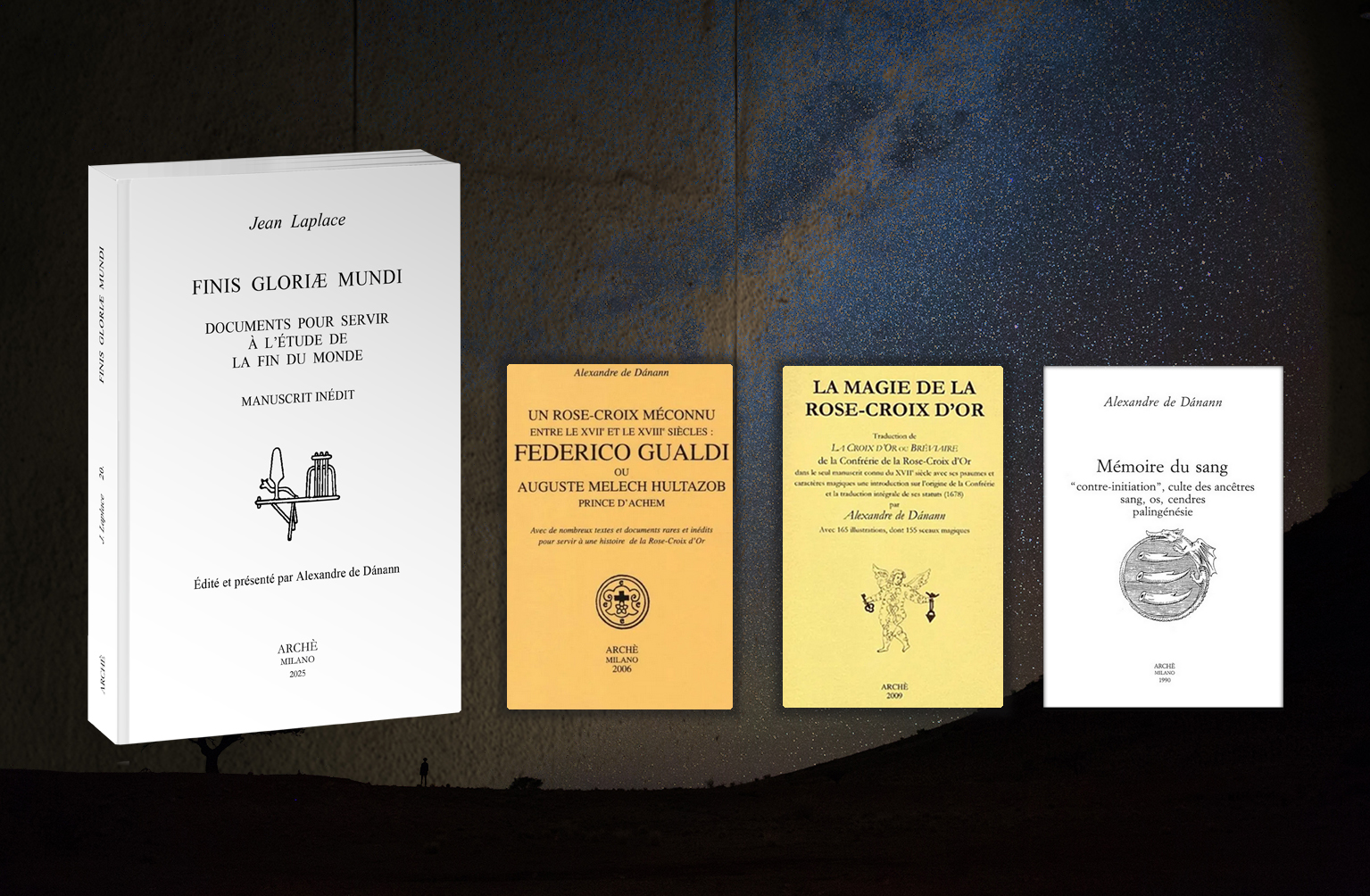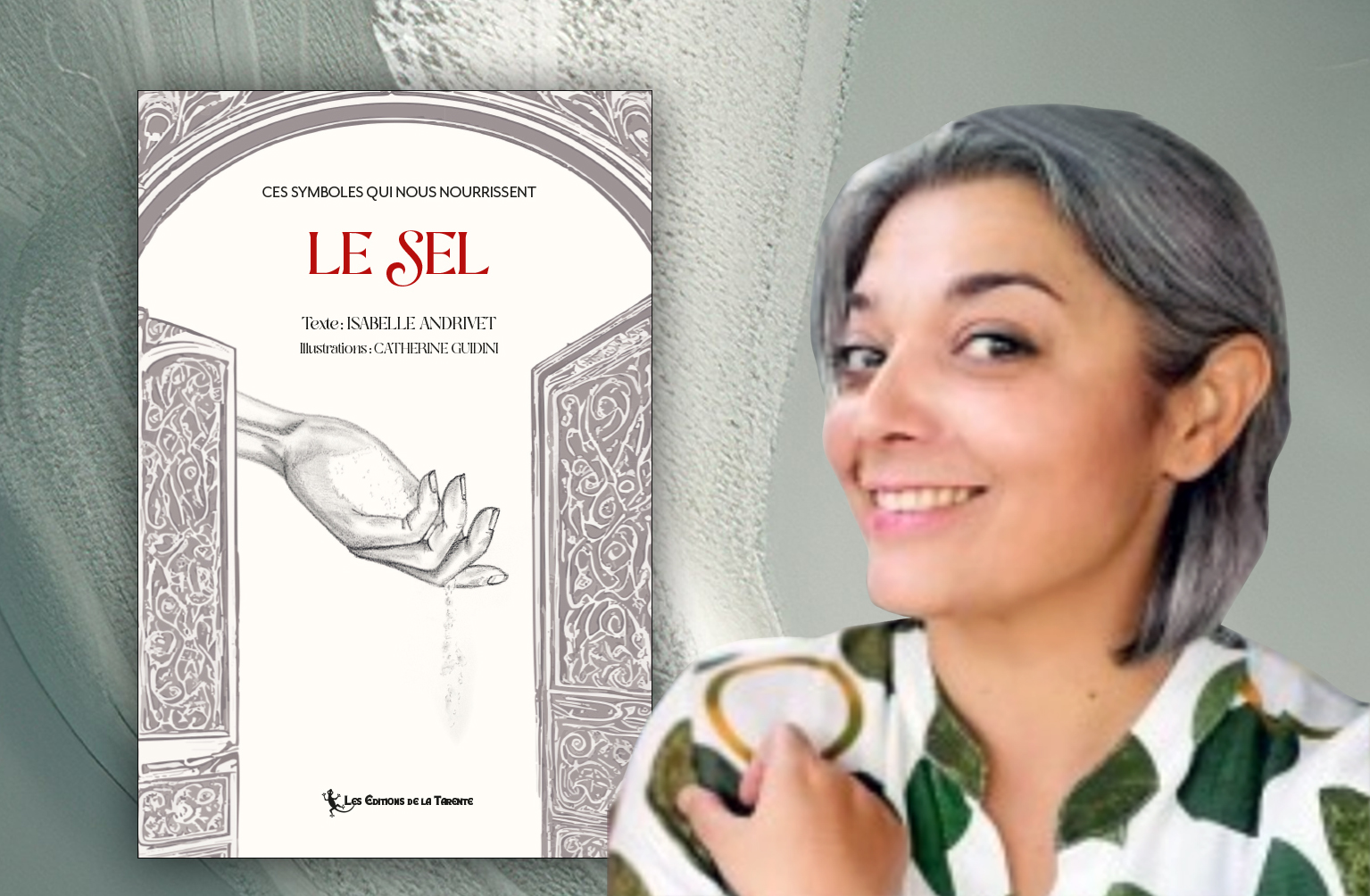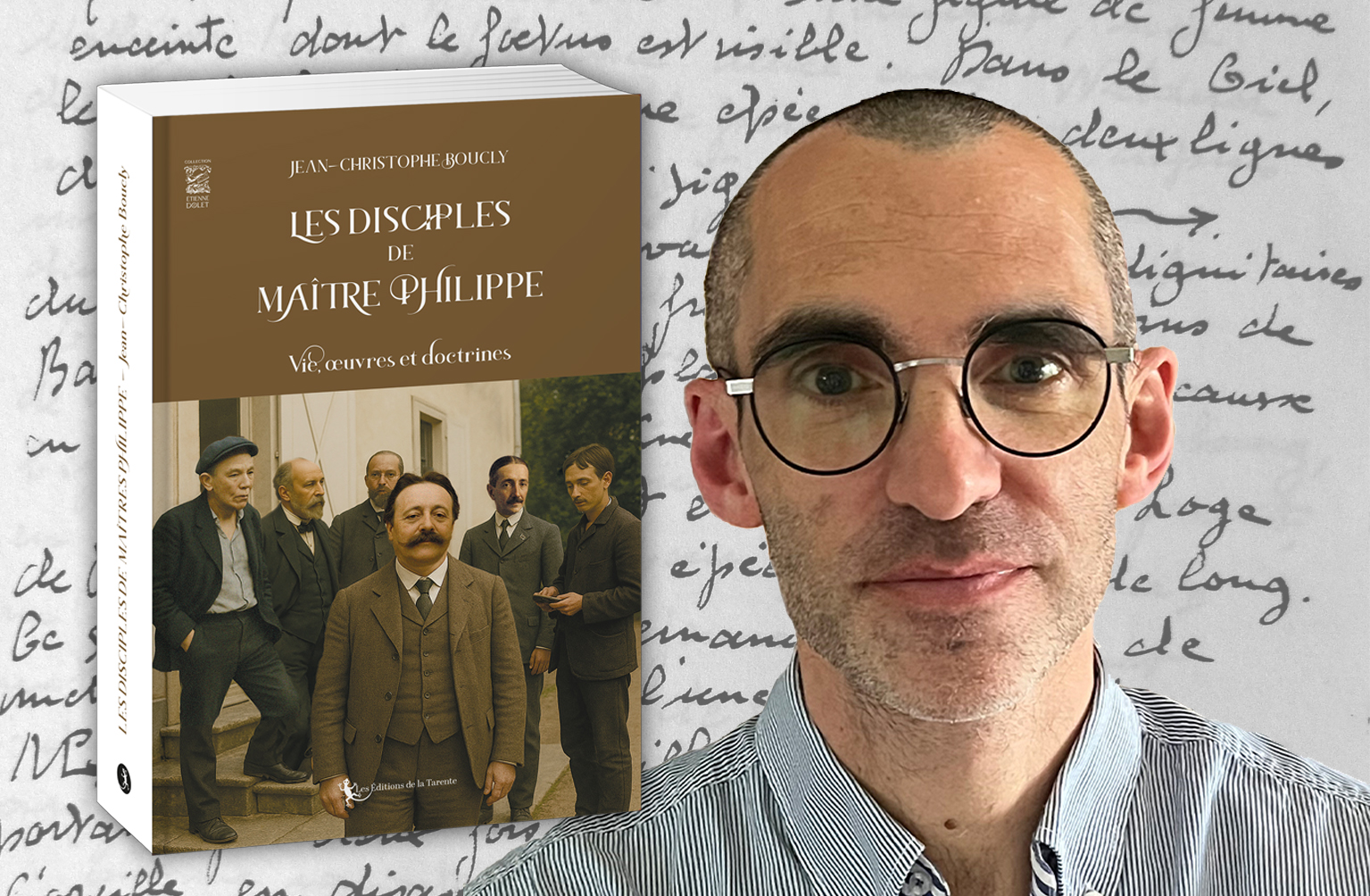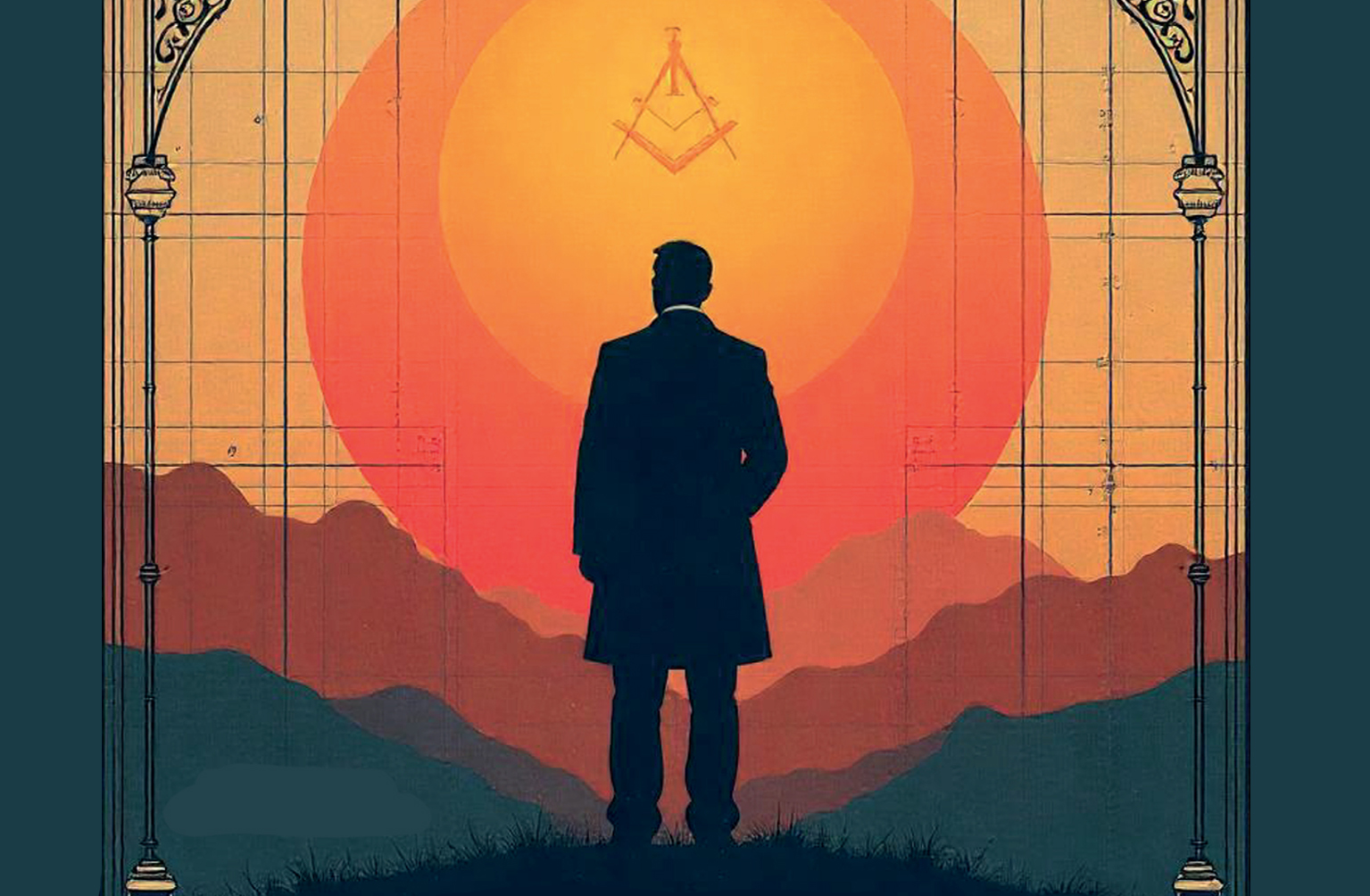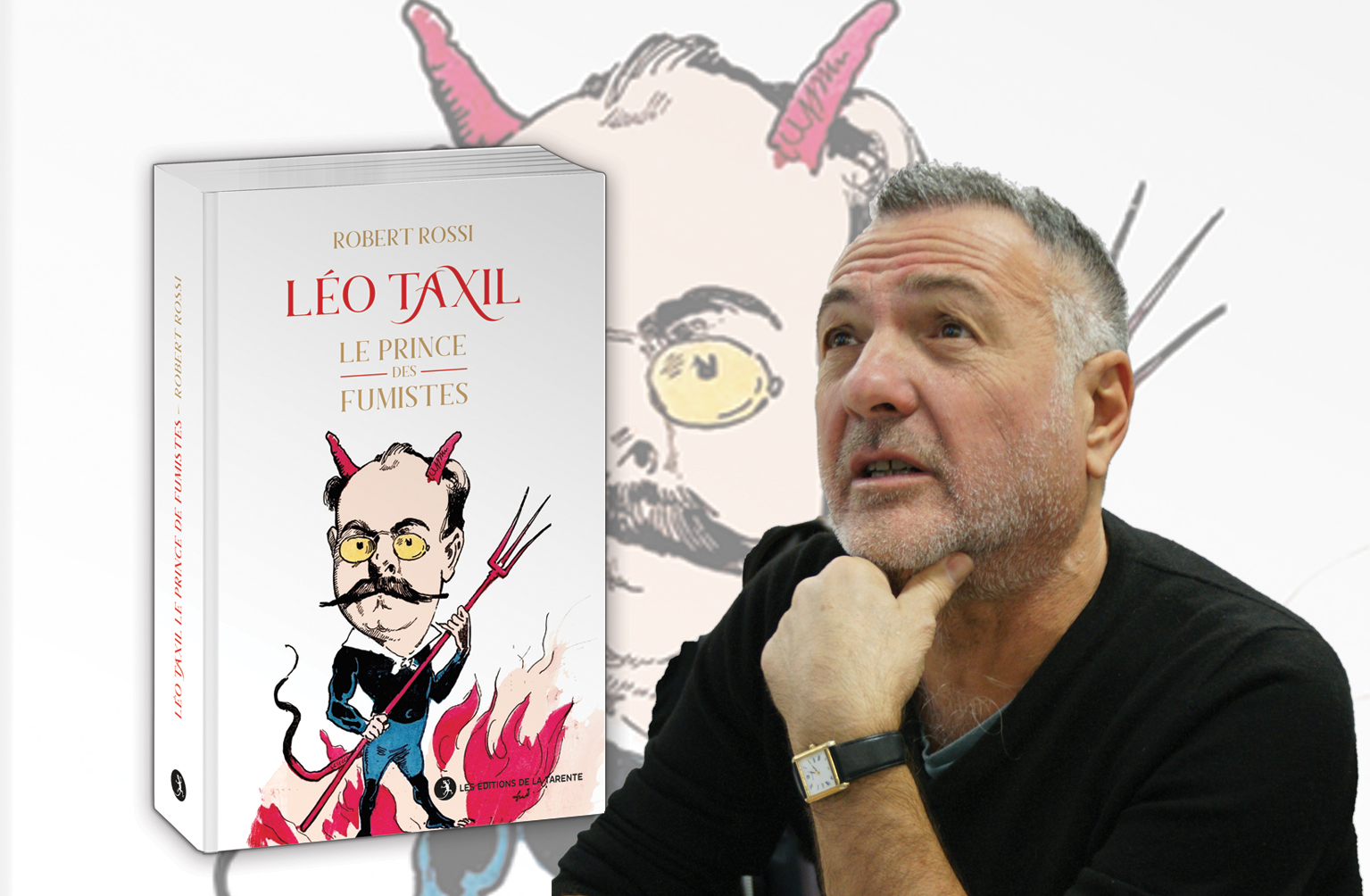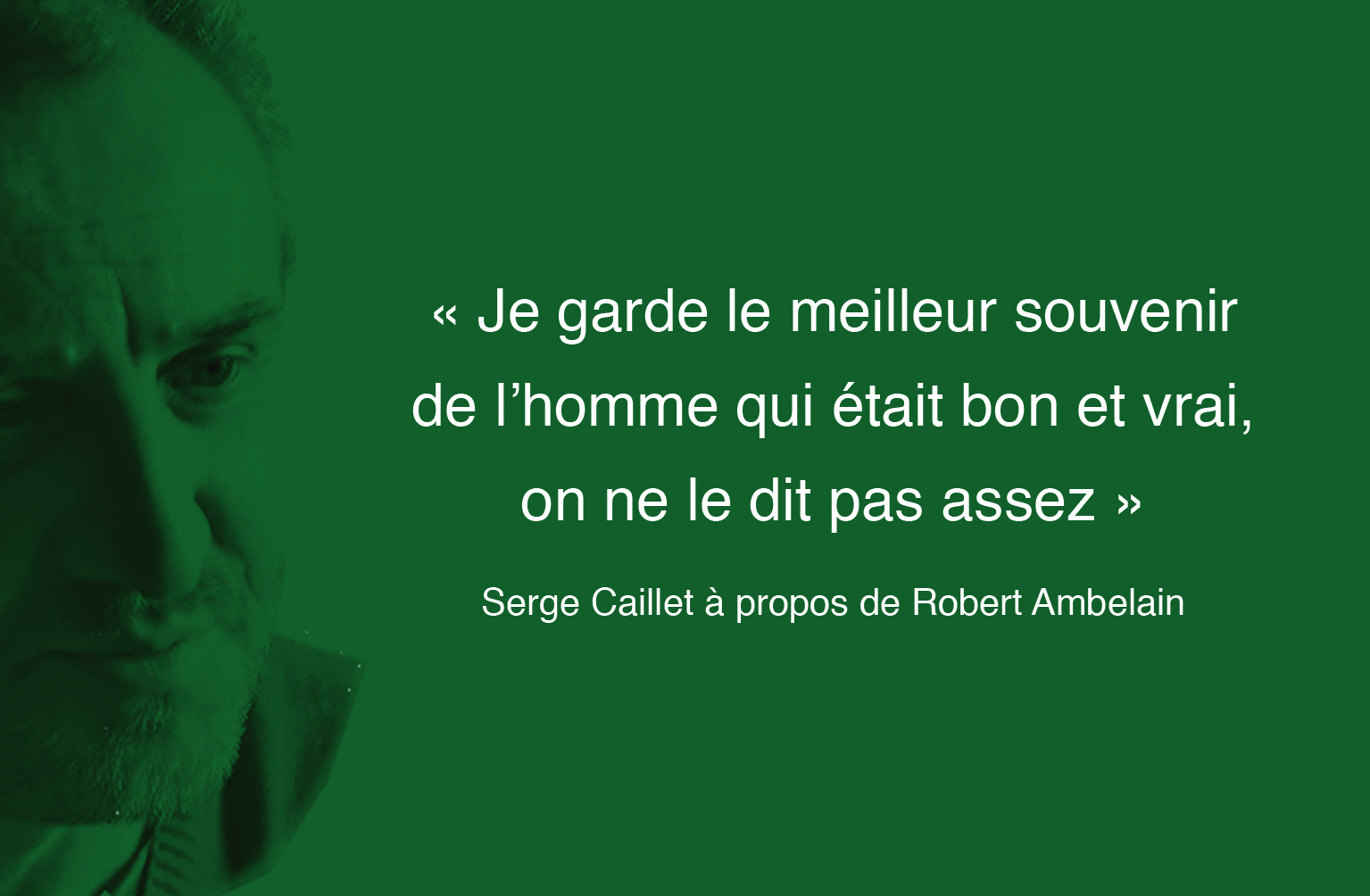
Entretien avec Serge Caillet
Historien et auteur de nombreux ouvrages parus aux Éditions de La Tarente dont « Robert Ambelain, le théosophe clandestin », Serge Caillet est tombé dans le chaudron de l'occultisme dès l'âge de dix-huit ans. Cet auteur prolifique et infatigable chercheur évoque pour nous les rencontres qui ont jalonné son itinéraire, notamment celle, décisive, de Robert Amadou, « un véritable coup de foudre initiatique » et lève le voile sur ses futurs projets.
La Tarente : Votre carrière d’auteur et d’historien de l’occulte serait trop longue à présenter ici mais votre carrière d’écrivain est fort bien remplie et déjà longue. Vous avez commis vos premiers écrits à l’âge de 18 ans. Comment le virus de l’occultisme vous a-t-il été inoculé ?
Ce n’est pas un virus, c’est une bénédiction ou une vocation, comme vous voudrez. Mon entrée dans la carrière, comme aurait dit Saint-Martin, je la dois à Jacques Bergier et à ce qui subsistait alors d’un grand mouvement dit du « réalisme fantastique », à la fin des années 70. Tout de suite - j’avais quinze ans – j’ai été happé par l’alchimie, y compris assez vite, par des travaux de laboratoire, et, bien entendu par l’étude des anciens, à l’école Fulcanelli-Canseliet, qui n’était pas encore passée de mode. Dans le même temps, je me suis intéressé à la Rose-Croix, aux sociétés initiatiques en général et, à dix-huit ans, je suis entré dans l’une d’elle, et dans quelques autres ensuite.
J’avais aussi commencé à écrire et même à être publié. Et naturellement, je lisais, outre les anciens de différentes époques, les modernes : Jacques Bergier, comme je l’ai dit, mais aussi Louis Pauwels, Raymond Abellio, Pierre Mariel, Serge Hutin, Philippe Encausse, Robert Ambelain, Jacques Breyer, Raymond Bernard…, dont certains sont d’ailleurs assez vite devenus des amis. C’est alors, à dix-neuf ans, que ma rencontre avec Robert Amadou a été décisive, déterminante pour une vie entière. Un véritable coup de foudre initiatique, à la vie à la mort. Et c’est Robert, véritablement, qui m’a lancé, en m’ouvrant bien des portes, y compris pour mes premières publications.
La Tarente : Vous avez écrit pour les Éditions de la Tarente quatre ouvrages et participé à l’édition de sept autres livres. Le dernier, Robert Ambelain le théosophe clandestin est un hommage à un homme parfois décrié mais surtout un infatigable défricheur de pratiques ésotériques. Comment l’avez-vous connu ? A-t-il été un moteur dans votre vie spirituelle ?
Singulièrement, ce n’est pas Robert Amadou qui me mit en relation avec Robert Ambelain, mais Philippe Encausse. J’avais lu, comme je viens de le dire, un certain nombre d’ouvrages d’Ambelain, notamment l’Alchimie spirituelle, le Sacramentaire du rose-croix, la Magie d’Abramelin le mage, et d’autres. Je correspondais avec Philippe Encausse sur d’autres sujets et c’est lui qui m’invita à prendre langue avec Robert Ambelain auquel je souhaitais poser des questions techniques. C’est seulement ensuite que nous avons abordé des problèmes d’histoire, notamment à l’occasion de la rédaction de la première édition de ma Franc-maçonnerie égyptienne de Memphis-Misraïm, publiée chez Cariscript, en 1988, grâce à Robert Amadou et à Antoine Abi Acar d’éternelle mémoire. Robert Ambelain n’était pas du tout content de certains passages de ce livre dans lequel j’abordais notamment les bagarres d’avant-guerre, dont il estimait qu’il ne fallait pas les mettre sur la place publique. Robert Amadou tenait absolument – et il avait raison – que j’obtienne l’accord d’Ambelain pour cette publication. J’ai tenu compte de certaines de ses observations et il a fini par me le donner. Dans la décennie qui a suivie, nous avons surtout correspondu, mais nous avons aussi fait quelques projets, dont celui de la réédition de son Dragon d’or que nous avons préparée ensemble peu de temps avant son rappel à Dieu, et qui est sortie chez Dervy après sa mort.
Je ne peux pas dire que j’ai jamais considéré Robert Ambelain comme mon maître dans aucun domaine, et certainement pas en histoire ! Mais certains de ses livres, dont ceux que j’ai mentionnés à l’instant, et d’autres de la même période, m’ont beaucoup marqué, beaucoup fait réfléchir, beaucoup servi aussi sur un plan pratique. Ensuite, sur un plan proprement initiatique, il serait bien injuste de ma part de ne pas lui reconnaître ma dette, qui est grande. Enfin, je garde le meilleur souvenir de l’homme qui était bon et vrai, on ne le dit peut-être pas assez.
La Tarente : Les Éditions de la Tarente préparent une réédition d’un ouvrage d’A.D. Grad et vous allez y mettre votre grain de sel. Voilà encore un personnage singulier dans ce microcosme qui nous intéresse. Vous l’avez aussi connu. Quelle place occupe-t-il dans le monde de la kabbale ?
C’est en 1988 que Robert Amadou me présenta Adolphe Grad, à Paris, à l’occasion d’une réunion d’un groupe de travail interdisciplinaire (médecine, théologie, astrologie, kabbale…) que nous avions constitué pour une réflexion sur « le Sida face à la Tradition ». C’était un personnage extraordinaire, fort sympathique, un orateur d’une certaine verve. Nous avons sympathisé immédiatement. Mais il était alors sur le point de quitter la France pour s’installer aux Caraïbes, où il a d’ailleurs fondé une école de kabbale. Nous avons alors correspondu, et il a toujours répondu à mes sollicitations avec une extrême gentillesse, pour des collaborations littéraires notamment. C’est ainsi que je lui avais proposé de rééditer Le Meurtre fondamental, que je tiens pour son meilleur livre, et j’avais trouvé sans difficulté un éditeur. Pour diverses raisons, ce projet resta en plan. Le temps a passé, Adolphe Grad a rejoint le sein d’Abraham… Et je suis évidemment très heureux et très honoré de pouvoir aujourd’hui lui rendre ainsi hommage, en menant ce chantier à son terme grâce aux Editions de la Tarente.
Alors, quelle place Adolphe Grad occupe-t-il dans le monde de la kabbale ? Une très grande place et une place à part. Ce n’était pas un kabbaliste académique, si vous me permettez l’expression. C’était un initié dont la kabbale, quoique parfaitement étayée sur les textes traditionnels, faisait aussi la part belle à une certaine imagination qui participait de son enseignement. Plus d’une fois, Grad nous déroute ! Mais c’est pour mieux nous ramener sur la route idéale d’une kabbale tout à fait authentique dont témoigne, du reste, toute sa vie, toute son œuvre sur plusieurs décennies.
La Tarente : Mais ce n’est pas le seul projet que nous avons en commun. Peut-être un voyage en martinisme ? Pouvez-vous lever un coin du voile sur ce projet ?
Rien de secret ! Voilà longtemps que j’ai annoncé ce livre à la documentation duquel je me suis attelé voilà presque une vingtaine d’années. Cette histoire de l’Ordre martiniste, puisque c’est de cela qu’il s’agit, Robert Amadou avait prévu de l’écrire, sous le titre : la Tradition martiniste. Hélas, tant d’autres chantiers ouverts ou menés à bien par lui l’ont empêché de conduire ce chantier-là à son terme, et je suis le premier à le regretter. Peu après le rappel à Dieu de Robert, des amis m’ont convaincu de me mettre à la tâche, et je m’y suis donc attelé, en prenant le temps nécessaire. J’en suis aujourd’hui à la rédaction, déjà bien avancée, d’un gros livre, qui aura pour titre : Les Serviteurs inconnus. Histoire illustrée de l’Ordre martiniste. Comme son nom l’indique, cet ouvrage retracera dans le détail l’histoire de l’Ordre martiniste, depuis sa fondation par Papus, à la Belle Epoque, jusqu’à ses continuateurs sur plus d’un siècle, tant au sein de l’Ordre martiniste proprement dit qu’au sein des autres ordres martinistes qui en sont issus : Ordre martiniste et synarchique, Ordre martiniste traditionnel, Ordre martiniste des élus cohen, Ordre martiniste initiatique, etc. Je prends donc le titre « Ordre martiniste » dans un sens très large. Si tout va bien, ce gros livre devrait paraître à la Tarente en 2026, ce dont je me réjouis, parce que c’est toujours un vrai bonheur de travailler avec mon ami Pierre Rodeville et son équipe.